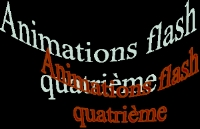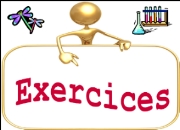|
Pour découvrir les différents outils utilisés en classe,clique sur les images.
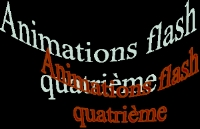  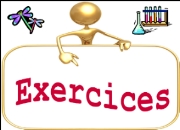 
Liens vers des sites utiles
Les séismes résultent d'une rupture brutale des roches en profondeur et se manifestent par des déformations à la surface dela Terre.
Des contraintes s'exerçant en permanence sur les roches conduisent à une accumulation d’énergie qui finit par provoquer leur rupture au niveau d’une faille :
- le foyer du séisme est le lieu où se produit la rupture ;
- à partir du foyer, la déformation se propage sous forme d'ondes sismiques enregistrables.
Les séismes sont particulièrement fréquents dans certaines zones de la surface terrestre. Ils se produisent surtout dans les chaînes de montagnes, près des fosses océaniques et aussi le long de l'axe des dorsales.
Le volcanisme est l'arrivée en surface de magma et se manifeste par deux grands types d’éruptions.
Les manifestations volcaniques sont des émissions de lave et de gaz. Les matériaux émis constituent l’édifice volcanique
L’arrivée en surface de certains magmas donne naissance à des coulées de lave, l’arrivée d’autres magmas est caractérisée par des explosions projetant des matériaux.
Le magma contenu dans un réservoir magmatique localisé, à plusieurs kilomètres de profondeur est de la matière minérale en fusion véhiculant des éléments solides et des gaz.
Les roches volcaniques proviennent du refroidissement du magma.
Les volcans actifs ne sont pas répartis au hasard à la surface du globe.
Sur les continents, des volcans actifs sont alignés, principalement autour de l’océan Pacifique et le long de grandes cassures. Dans les océans, les zones volcaniques se situent dans l’axe des dorsales océaniques.
La répartition des séismes et des manifestations volcaniques permet de délimiter les plaques.
Les variations de la vitesse des ondes sismiques en profondeur permettent de distinguer la lithosphère de l'asthénosphère.
La partie externe de la Terre est formée de plaques lithosphériques rigides reposant sur l'asthénosphère qui l’est moins.
Les plaques sont animées de mouvements qui transforment la lithosphère. (formation de chaînes de montagnes, déplacement des continents, ouverture et fermeture des océans. A raison de quelques centimètres par an, les plaques se forment et s'écartent à l'axe des dorsales.
Elles se rapprochent et s'enfouissent au niveau des fosses océaniques.
L'affrontement des plaques engendre des déformations de la lithosphère et aboutit à la formation de chaînes de montagnes.
L’activité de la planète engendre des risques pour l’Homme.
Le risque géologique est défini par l'éventualité qu'un phénomène dangereux survienne et par les dégâts humains ou matériels qu'il peut causer.
Le modèle tectonique actuel permet à l'Homme de définir les principales zones à risque sismique et/ou volcanique.
L'Homme réagit face aux risques qu'il connaît en réalisant :
- une prévention volcanique efficace qui passe par la prévision des éruptions fondée sur la connaissance du fonctionnement de chaque volcan ;
- une prévision sismique qui, moins aisée, peut faire place à une prédiction fiable.
L'Homme met alors en place un plan d'aménagement du territoire et d’information des populations.
La reproduction sexuée animale comme végétale comporte l’union d’une cellule reproductrice mâle et d’une cellule reproductrice femelle.
Le résultat de la fécondation est une cellule- œuf à l’origine d’un nouvel individu. L’union des cellules reproductrices mâle et femelle a lieu dans le milieu ou dans l’organisme.
Des mécanismes à l’échelle des individus et des cellules reproductrices favorisent la fécondation.
La reproduction sexuée permet aux espèces de se maintenir dans un milieu.
Les conditions du milieu influent sur la reproduction sexuée ainsi que sur le devenir d’une espèce.
Les ressources alimentaires du milieu influent sur la reproduction sexuée.
L’Homme peut aussi influer sur la reproduction sexuée et ainsi porter atteinte ou préserver ou recréer une biodiversité.
L'être humain devient apte à se reproduire à la puberté.
Durant la puberté, les caractères sexuels secondaires apparaissent, les organes reproducteurs du garçon et de la fille deviennent fonctionnels.
A partir de la puberté, le fonctionnement des organes reproducteurs est continu chez l’homme, cyclique chez la femme jusqu’à la ménopause.
Les testicules produisent des spermatozoïdes de façon continue.
A chaque cycle, un des ovaires libère un ovule. A chaque cycle, la couche superficielle de la paroi de l'utérus s’épaissit puis est éliminée : c’est l’origine des règles.
L'embryon humain résulte de la fécondation, puis de divisions de la cellule œuf qui se produisent dans les heures suivant un rapport sexuel.
Lors du rapport sexuel, des spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin. La fécondation a lieu dans l’une des trompes ; elle est interne.
L'embryon s'implante puis se développe dans l'utérus.
Si un embryon s’implante, la couche superficielle de la paroi utérine n’est pas éliminée : les règles ne se produisent pas, c’est un des premiers signes de la grossesse.
Des échanges entre l'organisme maternel et le fœtus permettant d’assurer ses besoins sont réalisés au niveau du placenta ; il représente une grande surface richement vascularisée.
Lors de l’accouchement des contractions utérines permettent la naissance de l’enfant.
Des méthodes contraceptives, permettent de choisir le moment d'avoir ou non un enfant. La contraception représente l’ensemble des méthodes ayant pour but d’empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel.
Ces méthodes empêchent :
- la production des cellules reproductrices ;
- la rencontre des cellules reproductrices ;
- l’implantation de l’embryon dans l’utérus. La diversité des méthodes de contraception permet à chacun de choisir celle étant la plus adaptée à sa situation.
Dans certaines conditions (rapport sexuel non ou mal protégé) la prévention d’une grossesse s’effectue par la prise d’une contraception d'urgence sous contrôle médical.
La commande du mouvement est assurée par le système nerveux qui met en relation les organes sensoriels et les muscles.
Un mouvement peut répondre à une stimulation extérieure, reçue par un organe sensoriel : le récepteur. Le message nerveux sensitif correspondant est transmis aux centres nerveux
(cerveau et moelle épinière) par un nerf sensitif.
Les messages nerveux moteurs sont élaborés et transmis par les centres nerveux et les nerfs moteurs jusqu’aux muscles : les effecteurs du mouvement.
Le cerveau est un centre nerveux qui analyse les messages nerveux sensitifs (perception) et élabore en réponse des messages nerveux moteurs.
Perception de l’environnement et commande du mouvement supposent des communications au sein d’un réseau de cellules nerveuses ou neurones.
La cellule nerveuse ou neurone transmet les messages nerveux aux autres cellules en produisant des messagers chimiques au niveau des synapses.
Le fonctionnement du système nerveux peut être perturbé dans certaines situations et par la consommation de certaines substances.
Les récepteurs sensoriels peuvent être gravement altérés par des agressions de l’environnement.
Dans le cadre de l’éducation à la santé ; les relations entre organes récepteurs et effecteurs peuvent être perturbées :
- par la fatigue ;
- par la consommation ou l’abus de certaines substances modifiant l’action de messagers chimiques au niveau des synapses.
La puberté est due à une augmentation progressive des concentrations sanguines de certaines hormones fabriquées par le cerveau ; elles déclenchent le développement des testicules et des ovaires.
Testicules et ovaires libèrent des hormones qui déclenchent l’apparition des caractères sexuels secondaires.
Les hormones ovariennes (œstrogènes et progestérone) déterminent l’état de la couche superficielle de l’utérus.
La diminution des concentrations sanguines de ces hormones déclenche les règles.
Les transformations observées à la puberté sont déclenchées par des hormones qui assurent une relation entre les organes.
Une hormone est une substance, fabriquée par un organe, libérée dans le sang et qui agit sur le fonctionnement d’un organe-cible.
Un accent sur la formation aux méthodes
Les études prévues en classe de quatrième permettent de poursuivre les apprentissages de capacités et d’attitudes dont la maîtrise est attendue en fin de classe de troisième.
Dans le cadre de la démarche d'investigation, l’occasion sera saisie, lorsque l’étude s’y prête, de renforcer l’approche au mode de pensée expérimental. Les apprentissages relatifs aux différentes capacités de la compétence Culture scientifique et technologique [Compétence 3] se trouvent renforcés. Dans des contextes qui se complexifient, on laissera une plus grande autonomie des élèves dans l’expression des résultats sous la forme de schémas fonctionnels, la mise en œuvre d’un certain nombre de gestes techniques (réalisation de préparations microscopiques, observation à la loupe ou au microscope). C’est l’occasion également d’entreprendre les apprentissages liés à l’élaboration de modèles simples et d’exercer la capacité de synthèse qui se développe progressivement chez l’élève de cet âge. Comme aux niveaux précédents, au delà de la compétence 3, des connaissances, des capacités et des attitudes d’autres piliers sont mises en œuvre.
Ce programme permet également un renforcement de l’acquisition de compétences sociales et civiques [Compétence 6].La préparation à la vie de citoyen trouve tout à fait sa place dans la partie La transmission de la vie chez l’homme : l’enseignement des sciences de la vie contribue à l’éducation à la sexualité ; les élèves sont informés pour évaluer les conséquences de leurs actes, sensibilisés pour respecter les autres, l’autre sexe, la vie privée ; ils devront être capables de faire preuve de jugement et d’esprit critique, de construire leur opinion personnelle et de pouvoir la remettre en question, de la nuancer, capacités qui se développent progressivement chez les élèves de cet âge.
Les activités proposées dans le cadre de cette classe doivent également permettre de développer l’autonomie et l’initiative des élèves. Si l’accent a été mis dans les classes précédentes sur le respect des consignes, il conviendra de trouver les espaces permettant aux élèves de mettre en place une démarche de résolution de problème.
Les capacités de la compétence 3 concernant l’expression des résultats, l’exploitation de textes, schémas, photos, tableaux, vidéogrammes, sont renforcées par les capacités de la compétence 1 : utiliser un vocabulaire de plus en plus riche, mais aussi dégager l’idée essentielle d’un texte, comprendre des textes variés, les résumer, rédiger un texte bref, comme un compte-rendu. Mais surtout les sujets abordés en classe de quatrième sont l’occasion de conduire l’élève à s’exprimer à l’oral, particulièrement en le faisant prendre part à un dialogue, à un débat.
L’accent mis sur les capacités pratiques et expérimentales suppose que les conditions de la formation pratique des élèves constitution de groupes à effectif restreint soient créées.
Comme ceux des niveaux précédents, le programme de la classe de quatrième offre différentes opportunités pour former aux compétences du référentiel du B2i-collège [Compétence 4]. Ces compétences sont réparties en cinq domaines :
*domaine 1 : s’approprier un environnement informatique de travail ;
domaine 2 : adopter une attitude responsable ;
domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données ;
domaine 4 : s’informer, se documenter ;
domaine 5 : communiquer, échanger.
A l’occasion de diverses activités visant des compétences du programme, l’élève peut être amené à utiliser les technologies de l’information et de la communication. Progressivement, il va ainsi acquérir également des compétences du référentiel du B2i. Il revient au professeur, en concertation avec ceux des autres disciplines, et en cohérence sur les quatre niveaux du collège, d’organiser la participation de son enseignement au suivi et à la validation de cette formation.
 
|